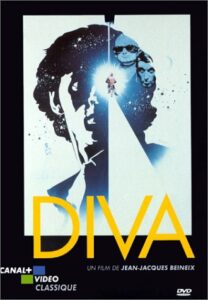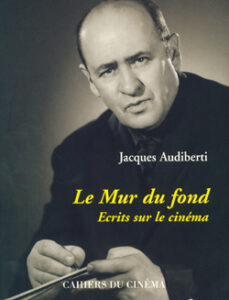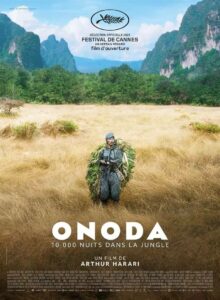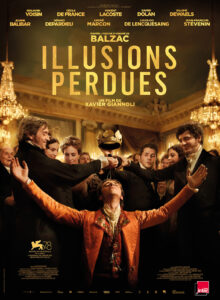Photo : Mathias P.R. Reding (Pexels)
Il est difficile d’être spectateur de films et de séries, lecteur de romans ou d’essais, tranquillement installé chez soi, tandis que la guerre fait des ravages en Ukraine depuis le 24 février, sur notre continent, l’Europe, où la paix était pourtant une valeur sûre. Cette guerre que mène la Russie contre l’Ukraine provoque des réactions intenses en France et dans le monde entier. C’est le retour du tragique dans l’Histoire, et cette histoire est la nôtre. Les images d’Ukraine, villes et campagnes ravagées, populations hagardes déambulant dans les ruines ou sur les routes de l’exode, hommes, femmes et enfants morts ou blessés, par centaines et par milliers, hôpitaux ou centres médicaux atteints ou détruits par des obus, tout cela suscite une énorme émotion. De même, les témoignages de la population ukrainienne reproduits dans la presse, à la radio ou à la télévision, nous bouleversent, nous nous sentons proches des Ukrainiens, parce que l’Ukraine est un pays démocratique qui a élu comme président un jeune comédien humoristique d’origine juive qui, dans ces circonstances dramatiques, a endossé avec panache son rôle de patriote, défendant avec vaillance l’intégrité et l’honneur de son pays. Kiev et Odessa sont des noms de villes qui nous sont familiers, elles font partie de l’Europe, de notre civilisation. Pour de multiples raisons : Soutien à l’Ukraine !

Vient de paraître la correspondance de François Truffaut avec des écrivains (1948-1984), chez Gallimard. Par ordre d’entrée en scène : Jean Cocteau et Jean Genet, les deux premiers écrivains avec qui François Truffaut entreprend une correspondance. Il écrit à Cocteau le 10 novembre 1948, il a tout juste 16 ans et anime avec son ami d’enfance Robert Lachenay un ciné-club, le Cercle Cinémane. Leur intention est de projeter Le Sang d’un poète au Cluny-Palace, boulevard Saint-Germain (une salle aujourd’hui disparue). Comment faire pour obtenir une copie ? Henri Langlois, le directeur de la Cinémathèque française, la leur refuse, il n’a pas confiance, sans doute craint-il que les deux jeunes abîment la copie du film. Truffaut, non sans culot, sollicite Cocteau en personne. « De votre présence ou absence dépend la vie ou la mort du Cercle Cinémane », lui écrit-il. Ce sera la mort. En effet, le père du jeune François, Roland Truffaut, qui en a marre d’éponger les dettes de son fils (qui n’est d’ailleurs pas son vrai fils, mais il l’a adopté) décide le faire enfermer dans un Centre pour mineurs délinquants à Versailles. Ce sera le début des années de galère du jeune Truffaut, si bien racontées dans Les Quatre Cents Coups. On se souvient des scènes où Jean-Pierre Léaud, son acteur fétiche et alter ego, est enfermé dans un centre de mineurs délinquants dont il décide de s’échapper. C’est la fin du film, avec la partie de football entre adolescents, et l’échappée solitaire du jeune Antoine Doinel courant vers le bord de mer, avec ce regard-caméra devenu historique, le dernier plan du film. Lors de la présentation du film à Cannes, en mai 1959, Jean Cocteau est là, à côté de Truffaut, timide, le regard apeuré, tandis que le jeune Léaud est porté en triomphe. Truffaut et Cocteau, une relation amicale qui dura jusqu’à la mort du poète survenue en 1963.

Sa première lettre à Jean Genet est datée du 19 mars 1951 ; Truffaut l’écrit depuis une prison militaire à Andernach, en Allemagne où, à la suite à une déception amoureuse, il s’est engagé dans l’armée française. C’est plus fort que lui, lors d’une permission il a choisi de déserter, préférant fréquenter la Cinémathèque à Paris, s’est fait attraper, il croupit dans sa cellule, puni d’avoir déserté – il n’en sortira que le 20 février 1952. Durant ce séjour en prison, Genet lui expédie livres et cigarettes, mots d’encouragement, il lui rend même visite, une amitié naît entre les deux hommes, Genet se reconnaît volontiers dans le jeune Truffaut au crâne rasé, rebelle à toute discipline, vêtu d’une tenue de prisonnier militaire. Leur amitié durera une bonne dizaine d’années, avant une fâcherie survenue en 1962, Genet reprochant au jeune cinéaste auréolé du succès des Quatre Cents Coups une attitude trop distante envers un des jeunes protégés de l’auteur du Journal du voleur.
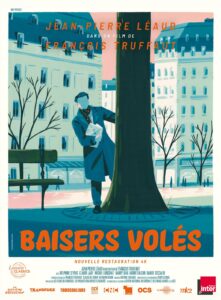
La troisième personne, écrivaine, avec laquelle Truffaut se lie et entame une correspondance assidue est Louise de Vilmorin. Leur correspondance commence en 1951, Truffaut n’a que 19 ans, et elle durera plusieurs années. Louise de Vilmorin, qui tient salon à Verrières, intime de Malraux, a fait la connaissance du jeune Truffaut lors d’un concours d’éloquence, en avril 1950, à Paris, au Club du Faubourg tenu par Léo Poldès. Truffaut y pratique brillamment l’art oratoire, manière sans doute de vaincre sa timidité. Il y excellera. Les échanges épistolaires entre Truffaut et Louise de Vilmorin sont marqués par une vraie courtoisie, un respect mutuel et galant. Née en 1902, l’écrivaine a alors cinquante ans, quand Truffaut approche la vingtaine. Le jeune homme s’exerce à l’art d’écrire à une femme auréolée du prestige d’avoir été l’autrice de Madame de…, que Max Ophuls réalisera en 1953, avec Danielle Darrieux et Vittorio De Sica. Ophuls sera un des cinéastes de chevet du jeune critique Truffaut, qui faillit même devenir son assistant sur Lola Montès, quelques années plus tard. Louise de Vilmorin inspirera Truffaut dans certaines figures féminines de son cinéma, Fabienne Tabard par exemple, admirablement jouée par Delphine Seyrig dans Baisers volés, envers qui Antoine Doinel nourrit une relation ouvertement amoureuse et timide.

Ce talent et ce culot du jeune Truffaut auteurs de lettres à des écrivains – outre Cocteau, Genet et Louise de Vilmorin, il eut ensuite une vraie correspondance avec Henri Pierre Roché (dont il adaptera deux romans : Jules et Jim en 1962, et Deux Anglaises et le Continent en 1971), Jacques Audiberti, Maurice Pons (dont Truffaut adapta une nouvelle en 1957 pour son court métrage Les Mistons), plus tard certains auteurs de la « Série noire » comme David Goodis, William Irish, sans oublier la riche correspondance entre Truffaut et Ray Bradbury, auteur du roman Fahrenheit 451, correspondance couvrant les longues années de préparation du film, ponctuées d’atermoiements, entre 1962 et 1965, le film se tournant enfin en janvier 1966 dans les studios de Pinewood, à Londres, toute cette correspondance avec des écrivains me semble marquée par deux traits essentiels. Tout d’abord une volonté farouche d’un jeune autodidacte (Truffaut n’a aucun diplôme scolaire en poche, il fut même un cancre, préférant faire l’école buissonnière avec son ami Lachenay) de côtoyer le monde littéraire, à travers un exercice d’admiration dont il avait le secret. Dans ses lettres marquées d’une réelle courtoisie et d’un vrai talent littéraire, le jeune Truffaut, et plus tard l’homme aguerri devenu cinéaste, manifeste un sens de la formule, de la pirouette, de l’adresse à des personnalités littéraires, faisant presque jeu égal dans le style épistolaire. Ecrire des lettres revient pour lui à s’élever dans un monde dont il perçoit vite les codes et les usages, une manière évidente d’affirmer déjà sa personnalité. L’autre dimension qui émane de cette correspondance avec des écrivains, relève de l’utilité scénaristique. Devenu cinéaste, il écrit à des écrivains et romanciers, ou parfois répond à des sollicitations de certains ou via leurs éditeurs, en vue d’adapter des romans. Sur les vingt-et-un longs métrages qu’il réalisa, entre 1959 et 1983, depuis Les Quatre Cents Coups jusqu’à Vivement dimanche ! son dernier film, Truffaut adapta à onze reprise des romans – soit à peu près la moitié de son œuvre. Le livre tint dans sa vie de lecteur, puis de critique, enfin de scénariste et réalisateur, une place primordiale. Il avait coutume d’acheter en plusieurs exemplaires les livres qu’il aimait, romans ou essais, biographies, un genre qu’il adorait, pour les offrir à des proches. En plus d’être un homme-cinéma, Truffaut était aussi un homme-livres. Ce dont témoigne admirablement la fin de Fahrenheit 451, lorsque les personnages, hommes et femmes, épris de liberté, se mettent à apprendre par cœur un roman entier, imaginant ainsi le sauver du feu et de l’oubli.
Il faut saluer l’excellent travail de Bernard Bastide, auteur de cette Correspondance avec des écrivains, pour l’important travail de classement et de recherche, pour la préface et les annotations indispensables au lecteur pour une meilleure compréhension de l’œuvre littéraire et épistolaire de François Truffaut.
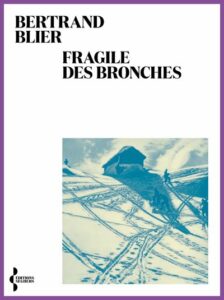
J’aimerais recommander un autre livre, celui de Bertrand Blier qui a pour titre : Fragile des bronches. On imagine que le personnage principal, qui s’appelle Jean-Michel Céleste, est un double de Bertrand Blier, âgé de 15 ans. Fils unique, il vit avec ses parents ; Raymond son père est un acteur très populaire, au cinéma comme au théâtre, souvent en tournage ou en tournée, tandis que Gisèle sa mère, passablement neurasthénique, vit et déambule dans son appartement en peignoir. Heureusement elle a Jacques, personnage ridicule mais sympathique qui est son amant, vendeur de machines à laver de son état, rencontré au cours d’un séjour en montagne où elle s’est rendue avec son fils Jean-Michel qui a besoin de l’air de la montagne pour soigner sa toux. Il y a aussi le copain de Jean-Michel, l’inséparable Blumberg, les deux amis s’envoient sans arrêt des vacheries, mais sont liés par une grande complicité et l’amour du jazz. Fragile des bronches est un livre très dialogué, extrêmement drôle et pince-sans-rire, loufoque et débridé, décapant et insolent, illogique, comme le sont souvent l’art et l’écriture de Bertrand Blier cinéaste. La trace ou l’empreinte de son œuvre cinématographique y est très présente, tantôt côté Buffet froid, tantôt côté Les Valseuses, ou d’autres de ses films. Le cinéma se lit donc entre les lignes, il est là, il affleure dans chaque page. Ce pourrait être une bande dessinée, on imagine presque les dessins au-dessus ou à côté du texte qui serait entouré dans des bulles, comme une véritable bd, tandis que Jean-Michel, sorte de Grand Duduche légèrement mélancolique, irait de scène en scène en racontant sa jeunesse parisienne, son premier amour avec Nicole, une fille de diplomate, son amour du jazz, tendance Sydney Bechet plutôt que John Coltrane, sa rencontre, émouvante, avec Henri-Georges Clouzot, l’ami de son père, à Saint-Paul de Vence.
Ce livre, récit ou roman, ne viendrait-il pas à la place d’un film qu’aurait aimé réaliser Bertrand Blier ? Quel film cela aurait donné ? Fragile des bronches pourrait-il faire l’objet d’une adaptation au théâtre ? Ou d’une lecture publique, avec plusieurs acteurs et actrices, ou lecteurs et lectrices ? Le plaisir en serait largement garanti. Ni un film ni une pièce, ce livre se lit vite et avec plaisir, on passe d’une scène à l’autre, on rit, cela ressemble parfois à du Jacques Tati par le caractère burlesque et incongru des situations, jeux de mots ou gags, on passe sans arrêt du coq à l’âne, ça rebondit, on se marre, on a vraiment envie d’être dans l’histoire, et on est triste quand Jacques, qui est vendeur de machines à laver, annonce qu’il veut la quitter, cette histoire. Bertrand Blier, aidé par Eva Bester, s’est vraiment marré à écrire ce livre. Et il nous transmet joyeusement son plaisir.
François Truffaut, Correspondance avec des écrivains, 1948-1984. Edition établie et présentée par Bernard Bastide. Gallimard.
Bertrand Blier, Fragile des bronches. Éditions Seghers.
Lire la suite »